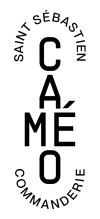Anti-squat
Entretien avec Nicolas Silhol, réalisateur
Dans Anti-Squat, on découvre les pratiques de ces sociétés qui sont chargées d’occuper des immeubles vides pour éviter les squatteurs. Peut-être pouvez-vous rappeler en quoi cela consiste ?
D’abord, rappelons que d’après le rapport de la Fondation Abbé Pierre, il y a 15 millions de personnes qui sont dans une situation fragile par rapport à leur logement. Ça représente près d’un quart de la population, ce qui en fait un sujet de préoccupation majeur. En faisant des recherches sur le mal-logement, j’ai rencontré Annie Pourre, une des fondatrices du Droit Au Logement (DAL), c’est elle qui m’a fait découvrir la « protection par l’occupation ». Ce concept existe depuis longtemps en Hollande et en Angleterre, mais est encore méconnu en France. Il a été inscrit en 2018 dans la loi ELAN à titre expérimental, et il se concrétise aujourd’hui avec la « loi anti-squat », en débat actuellement à l’Assemblée, qui va pérenniser cette pratique, ce qui permettra à des entreprises de loger des résidents temporaires dans des immeubles vacants pour les protéger contre les squatteurs. A la base, l’idée est simple et plutôt intéressante : il y a des millions de mètres carrés vacants et des millions de personnes qui ont des difficultés à se loger décemment, donc pourquoi ne pas mettre les uns au service des autres ? Les associations d’aide au logement réclament ce type d’espaces vacants, et avec le développement du télétravail, il en existe de plus en plus. Mais dans les faits, on se rend compte que la mise en pratique de cette idée est plus guidée par le profit que par l’humain. Et on se retrouve dans une situation d’exploitation de la précarité, comme dans le film. Les droits des résidents sont limités, ils sont soumis à un règlement drastique, intrusif, pour qu’ils ne se sentent pas chez eux. Avec Fanny Burdino, ma co-scénariste, nous avons trouvé que ce principe racontait quelque chose de notre époque : la restriction des libertés, la servitude volontaire et, face à ces dérives, la tentation de la révolte.
Votre personnage principal, Inès (Louise Bourgoin), est clivé, avec un pied de chaque côté de la fracture sociale. Elle risque de se faire expulser de son logement et elle gère un lieu où vivent des gens qui n’ont plus de logement.
Exactement. Au départ, Inès n’est pas précaire. C’est une mère célibataire qui élève seule son fils, en travaillant comme agent immobilier à son compte. Mais il suffit que son propriétaire veuille récupérer son appartement pour qu’elle se découvre du jour au lendemain dans une grande précarité. Pour trouver un appartement à louer à Paris aujourd’hui, il faut un CDI, une caution, de gros revenus… J’ai des amies qui sont mères célibataires et qui se sentent très vulnérables à cet endroit. Inès est hantée par la peur de se retrouver à la rue avec son fils. Elle est tiraillée entre le sale boulot que lui demande la société Anti-Squat qui l’emploie et les résidents auxquels elle s’identifie forcément. Comme dans CORPORATE, j’ai essayé de trouver le bon endroit : un personnage pris entre le marteau et l’enclume. Inès essaye de maintenir une distance avec les résidents pour ne pas trop s’identifier à eux, mais elle finit par se solidariser avec eux. J’aime explorer les zones grises où la morale devient incertaine. Dans cette période de flexibilité et de précarité, la morale elle-même devient flexible et précaire.
Votre film traite du suspens lié à la gestion de l’immeuble par Inès, mais aussi de la relation intergénérationnelle avec son fils.
J’avais à cœur de raconter l’histoire d’une femme qui se bat pour s’en sortir et qui est amenée à faire des choix difficiles sous le regard de son fils. Je suis moi-même père de deux adolescents, je mesure chaque jour à quel point ils grandissent dans un monde de plus en plus dur, avec des repères de moins en moins stables. En tant que père, j’essaye de les protéger, d’en faire des citoyens responsables, de leur inculquer le goût de se battre pour défendre leurs idées sans prendre de mauvais coups. Quand ils étaient plus jeunes, je les emmenais en manif’ pour éveiller leur conscience politique. Ensuite, cela n’a plus été possible parce que les manifs devenaient trop violentes. Et maintenant, je dois raisonner mon fils pour qu’il n’aille pas participer au blocus de son lycée. Voilà : mes enfants ont grandi, j’ai vieilli, ils sont plus en colère que moi. J’avais envie de parler de ce flambeau de la révolte qui passe d’une génération à l’autre. On voit bien aujourd’hui comment les jeunes s’emparent des sujets qui les inquiètent et en tant que parents, on a parfois du mal à se positionner par rapport à leur colère.
Le sociologue Max Weber distinguait l’éthique de responsabilité et l’éthique de conviction. Inès oscille entre ces deux notions ?
C’est cela. Et le plus important, c’est que ces notions s’incarnent à travers le regard du fils. Adam est le témoin des mensonges de sa mère, de ses compromissions, de sa fuite en avant. Inès l’a élevé avec un certain nombre de valeurs auxquelles lui la renvoie, et elle va devoir privilégier son intérêt particulier, retrouver un emploi et un logement, contre l’intérêt collectif et la résistance des résidents. C’est de plus en plus difficile aujourd’hui de se forger une éthique de conviction.
Est-ce plus difficile encore pour des parents, qui souhaitent à la fois protéger leurs enfants et les préparer à affronter le monde ?
Oui, c’est la situation d’Inès. L’important est de ne pas la juger, pas plus que les personnages antagonistes. On voit que Thomas, son patron, incarne une idéologie dans l’air du temps, avec un certain cynisme, mais sa société est elle-même dans une situation précaire, lui aussi essaye de s’en sortir comme il peut. L’idée est de ne pas juger les personnages mais de mettre en place des situations dans lesquelles ils sont acculés à faire des choix. Dans la chaîne des décisions et des responsabilités, il y a souvent un N+1 à qui on doit rendre des comptes.
Inès fait le sale boulot pour son fils mais doit affronter son regard critique. Encore un nœud de complexité et de tension dramaturgique.
Inès et Adam ont une relation forte, ils s’en sont toujours sortis ensemble, ils forment une bonne équipe. Mais cette équipe mère-fils est mise à mal : elle est obligée de le laisser seul, livré à lui-même. Lui est aussi inquiet pour elle, il a envie de la protéger. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre met l’accent sur les mères célibataires : elles sont parmi les principales victimes du mal logement.
Les résidents ne sont pas des marginaux mais des gens qui ont un métier, un revenu… Vous montrez que la précarité touche la classe moyenne.
Ce sont ceux que l’on appelle les travailleurs pauvres. Aujourd’hui, avoir un métier ne suffit pas toujours à s’assurer une situation stable et décente. Parmi les conditions de recrutement d’Anti-Squat, les candidats doivent avoir un contrat de travail. C’était important de montrer que les précaires sont aussi des gens qui ont un métier, des revenus, mais ne parviennent pas à avoir un logement stable compte tenu du marché immobilier. Les résidents incarnent un petit échantillon de la société : un prof, une infirmière, donc des fonctionnaires qui renvoient à la précarité des services publics, mais aussi un jeune chauffeur de VTC, emblématique de l’ubérisation et de la débrouille des jeunes, une représentante de commerce plus âgée… Cela posé, je ne voulais pas être misérabiliste mais montrer des gens qu’on ne soupçonnerait pas habiter des bureaux vides en banlieue.
Le sujet du film est social, mais votre mise en scène n’est pas du tout naturaliste, elle est au contraire stylisée, architecturale, comme dans un film dystopique.
Absolument. C’est comme cela que j’en parlais avec les gens avec qui je travaillais : un film d’anticipation immédiate. J’ai fini d’écrire ce film pendant le confinement, moment où on s’interrogeait beaucoup sur le « monde d’après ». Mon intention était de donner cette vision d’un monde d’après où des travailleurs motivés, flexibles et précaires exploitent d’autres travailleurs motivés, flexibles et précaires dans une zone de banlieue non identifiée. Ce monde de demain, c’est déjà aujourd’hui.
Il y a dans votre mise en scène un sens très fort des lieux.
L’immeuble a été pensé dès le départ comme un personnage à part entière. J’étais très attiré par ce type de décors abandonnés, désolés, vertigineux, où la nature reprend ses droits. Ils ont un côté ruines modernes qui me fascinait. Avec le chef déco, Jérémy Duchier, et le chef opérateur, Pierre Maïllis-Laval, on souhaitait tirer profit de toutes les potentialités visuelles et sonores de ces lieux vides. Dans cet immeuble se diffuse un sentiment d’inquiétante étrangeté, une menace semble planer, mais on ne sait pas trop d’où elle va surgir. L’idée était de transmettre ce parfum anxiogène. La musique renforce cela, avec une vraie bande-son de l’immeuble faite à partir de sons naturalistes traités, filtrés, comme si l’immeuble était un personnage inquiétant. Visuellement, j’avais axé Corporate sur les gros plans, les visages ; là, on souhaitait tirer profit des décors, inscrire les acteurs dans ces espaces, donc déployer des plans géométriques qui les enferment et les observent, avec un regard d’entomologiste. Ce sont des individus qui se cherchent, qui s’observent, dans des espaces vides, et qui finissent par se connecter. Il y avait aussi l’intention d’inscrire ces plans dans la durée. Dans cette grammaire épurée, les gros plans sont encore plus forts.
En effet, la froideur de la mise en scène est très cohérente, elle traduit celle du monde ubérisé que vous décrivez et fait du film un bel objet de cinéma. Par ailleurs, le film comporte aussi des moments chaleureux dans les rapports mère-fils, ou entre les résidents. En somme, la société est froide, mais les individus sont « chauds ». Sur cette tension entre froideur moderne et chaleur humaine, le film m’a fait penser à Playtime de Jacques Tati.
Je n’y avais pas pensé ! L’intérêt, c’est que l’humain finit par s’affirmer dans ces décors vides et inhumains. Inès, son fils Adam et les résidents finissent par former un groupe qui se libère et qui s’affirme dans la résistance. Au niveau des références, j’ai plus pensé au Voleur de Bicyclette de Vittorio De Sica, pas pour le style, mais pour le regard d’un enfant sur son père qui essaye de s’en sortir et finit par être acculé à voler après avoir été lui-même volé. La morale, c’est que les pauvres doivent se voler entre eux pour s’en sortir : c’était ma référence sur le sujet. Sur l’opposition froideur-chaleur, on la retrouve dans l’utilisation des images vidéo : il y a des images de vidéo-surveillance, qui enferment les personnages, et puis les vidéos des raps d’Adam à travers lesquelles il exprime ses sentiments, sa colère.
Cela se traduit aussi dans les personnages et la direction d’acteur, notamment avec Louise Bourgoin, remarquable en femme clivée intérieurement.
Avec Louise, je voulais travailler l’ambivalence de ses deux visages : celui chaleureux, intime, complice de la relation avec son fils, et le visage du sale boulot qu’on lui demande de faire. Quand elle doit gérer les résidents, elle a un visage plus dur, distant, comme si Inès aussi jouait un rôle. Louise a cette force-là, une économie de jeu que j’aime beaucoup. Elle a construit ici un personnage très en contrôle, qui craque deux ou trois fois au cours du film, moments où elle montre la fragilité d’Inès. C’est courageux de sa part d’avoir composé cette partition-là qui consiste à jouer un personnage a priori antipathique. Mais on sait pourquoi Inès fait ce job et on est avec elle.
Qui a écrit et composé les raps ? Samy Belkessa, l’acteur excellent qui joue Adam ?
J’ai eu la chance de rencontrer Samy Belkessa, il n’avait jamais joué, jamais chanté, et a répondu à l’annonce de Tatiana Vialle (directrice de casting) sur Facebook. Ça a été une révélation pour nous, et pour lui ! Pour son personnage, je me suis inspiré de mon propre fils Pierre-Loup qui a commencé à écrire du rap pendant le confinement. C’était sa manière de s’exprimer. Après, je lui ai demandé d’écrire sur la vie des personnages du film. Les raps évoluent au cours du film : au début, c’est sur la vie quotidienne d’Adam avec certains clichés du rap, puis au contact des résidents, Adam commence à raconter les autres. Inès finit par être fière des raps de son fils.
Antoine Gouy est très bon en patron à la fois cool et cynique.
Je l’avais découvert dans Camille, de Boris Lojkine, où il crevait l’écran. Ici, il joue un entrepreneur plutôt sympathique et confronté lui-même à une situation précaire. Les jeunes start-uppeurs sont souvent dans ce type de situation. Mais dans ce monde-là, le droit du travail en a pris un coup. Antoine est parfait dans cette ambivalence du « connard sympa ».
Comment avez-vous trouvé Ike Ortiz, qui joue le résident chauffeur de VTC ? Il est d’un naturel bluffant.
Je construis des personnages qui sont représentatifs. Le risque serait qu’ils se réduisent à leur fonction. Chauffeur de VTC aujourd’hui, ça peut virer à la caricature. L’intérêt est d’aller chercher des acteurs qui vont rendre la fonction vivante. Je suis attaché aussi à l’idée de faire découvrir des visages, des acteurs qu’on ne connaît pas. Lui et Soraya qui joue l’infirmière, je les ai rencontrés à l’école d’acteurs de Kourtrajmé. Les acteurs qui jouent les résidents viennent d’horizons très différents, comme leurs personnages : de Kourtrajmé, du théâtre, il y a aussi Sâm Mirhosseini (qui joue l’ouvrier roumain) qui est iranien et a eu un parcours incroyable… Il a été champion du monde de boxe thaï, fait la Légion étrangère… Je trouvais intéressant de réunir des gens aux parcours très différents, des acteurs qui savent aussi bien ce qu’est la précarité.
En dehors des raps, qui a composé la musique ?
J’ai fait appel à deux veines très différentes. D’un côté les frères Kourtzer qui viennent du hip-hop, qui ont fait la B.O. de Ma Cité va cracker : ils ont composé les raps et la bande-son de l’immeuble avec leurs machines électroniques. De l’autre côté, Alexandre Saada, qui est pianiste de jazz et a apporté le thème du personnage d’Inès. C’est un thème plus mélodique, plus organique, plus chaleureux pour reprendre l’opposition froideur-chaleur.
Comment s’est passée l’écriture avec Fanny Burdino, scénariste expérimentée ?
Ça a été un long travail dans la durée. On a rencontré des résidents. On a beaucoup réfléchi ensemble autour du personnage d’Inès, avec ses dilemmes successifs qui sont de plus en plus difficiles à trancher. J’écrivais d’abord, Fanny repassait dessus avec des propositions, ça fonctionnait comme un ping pong. Elle m’a bien accompagné, du début à la fin du processus.
La fin est à la fois douce-amère et ouverte : Inès a grimpé dans la hiérarchie d’Anti-Squat mais regarde avec bienveillance son fils participer au blocus de son lycée. Il y a transmission de l’esprit de révolte ?
Oui, c’est ça. Cette fin est dure pour Inès parce qu’elle a fait un choix douloureux et en est affectée. Elle est en quelque sorte devenue sa fonction. Mais Adam, son fils, prend le relais de la révolte. C’est ma conviction : les jeunes ont repris le flambeau, peut-être plus radicalement que ma génération. Adam regardait Inès avec désapprobation, mais Inès regarde désormais son fils avec une certaine fierté. Adam a connu un parcours initiatique et s’émancipe. Il ne juge pas sa mère mais choisit de se battre. Le champ du combat reste ouvert.
(Dossier de presse)