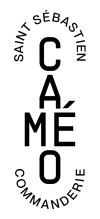àma Gloria
Entretien avec Marie Amachoukeli, réalisatrice
Propos recueillis par Baptiste Etchegaray, mars 2023
Le film est dédié à Laurinda Correia, qui est‑elle ?
Laurinda est la femme qui s’est occupée de moi quand j’étais petite, elle était la concierge de l’immeuble où je vivais. Elle était issue de l’immigration portugaise, et j’ai vécu une grande partie de mon enfance dans sa loge avec ses enfants. Quand j’avais six ans, elle m’a annoncé qu’elle retournait au pays avec son mari pour ouvrir un établissement et refaire sa vie auprès des siens. Ça a été la première grande déflagration de ma vie. Aujourd’hui, on est toujours en contact, on s’envoie des cartes, elle me souhaite mes anniversaires et quand je vais dans sa maison au Portugal il y a des photos de moi au milieu de celles de ses enfants et petits-enfants. Elle continue de m’appeler « ma fille ».
Avec ce film, j’avais envie de raconter la place de quelqu’un qui s’occupe d’un enfant pour gagner de l’argent car c’est son travail, et comment parfois cela déborde. Dans notre société, où la place de la mère est sacralisée, je crois que c’est tabou de dire qu’il n’y a pas que les parents qui peuvent avoir un amour débordant pour leurs enfants, ou qu’à l’inverse un enfant peut ressentir cet amour-là, absolu, pour une personne qui n’est pas son parent. Tu ne le dis même pas à ta propre famille. C’est un amour secret, presque clandestin, qui n’est jamais formulé. Et justement parce qu’il est secret, j’ai eu envie de le raconter.
Le rôle de la nourrice, de la baby-sitter, a été représenté au cinéma, mais dans des registres très différents. Pourquoi avoir voulu raconter l’histoire de ce personnage ?
Je trouvais fou de me dire que tous les jours, ici ou ailleurs, il y a des femmes qui s’occupent d’enfants qui ne sont pas les leurs. Ces femmes font partie de la vie quotidienne de millions de familles, mais c’est comme si on ne voulait pas les regarder, ou alors de loin, et encore moins s’interroger sur notre rapport à elles. On les nomme par leur fonction, « nounou » dans le meilleur des cas, mais derrière il y a évidemment plus qu’une fonction.
Quand j’écrivais le film, une Américaine m’a dit : « It’s a nanny movie ! » C’est un genre en soi aux Etats-Unis, mais ce sont plutôt des comédies type Madame est servie ou Mrs Doubtfire... Et bien sûr Mary Poppins, qui est le film culte de mon enfance. C’est même LA référence de mon film, avec ce principe de mélanger fiction et animation. A chaque fois que je le revois, je trouve ça génial, pas seulement parce que c’est merveilleusement joué, chanté et dansé, mais parce que c’est l’histoire d’une nourrice débarquée d’on ne sait où, qui entretient un lien très fort avec des enfants pendant que leurs parents sont occupés ailleurs. Mary Poppins éprouve une tendresse folle pour ces deux enfants, et réciproquement, mais les conventions font que ça ne doit pas s’exprimer. Tout le film transpire cet amour mais il n’est jamais dit ni formulé. C’est crypto, en un sens.
Vous avez eu envie de faire un « nanny movie » qui ne serait pas une comédie ?
Le principe dramaturgique du film, c’est l’amour impossible, secret et tabou, donc le mélo. Avec une série d’oscillations violentes entre des moments de bonheur fou et des moments de mélancolie absolue. Donc oui, j’ai voulu faire un mélo. Car j’adore aussi Loin du Paradis de Todd Haynes ou encore les films de Douglas Sirk que je regardais avec ma grand-mère, des larmes dans les yeux et des mouchoirs dans les poches.
Cette relation « mère-fille » est doublée d’une autre relation taboue : le rapport nord-sud.
Gloria est ce qu’on appelle une migrante économique : elle est venue en France pour travailler et subvenir à ses besoins. C’est le tabou d’une relation désaxée, de l’héritage de la colonisation qui a fait la domination d’un continent sur un autre. J’ai d’ailleurs tenu à montrer qu’il est ici question d’argent, sans le mettre sous la table, au prétexte qu’on parle d’amour. Du coup je pose la question à plusieurs endroits dans le film. Est-ce que c’est un amour tarifé ou un vrai amour ? Est-ce que c’est un travail ou une vocation tendre ?
Il existe une injustice par rapport aux enfants de Gloria restés au Cap-Vert. C’est un cas qu’on retrouve en permanence : des enfants qui grandissent sans leur mère parce qu’elle est obligée de se déplacer pour subvenir à leurs besoins. Qu’est-ce que ça questionne, ici et là-bas ? Pourquoi on en parle si peu alors que c’est si commun ? Qu’est-ce qu’on ne veut pas regarder ?
Avez-vous recherché des références historiques pour nourrir votre écriture ?
Il y a un tableau de Jean-Baptiste Debret peint au 19ème siècle qui m’a beaucoup marquée, en couverture d’un essai que j’ai lu durant l’écriture du scénario, L’Oedipe noir, de l’anthropologue Rita Laura Segato. On y voit une femme noire serrant fièrement dans ses bras un enfant blanc, à qui elle offre une protection enveloppante. En lisant le livre, on apprend qu’à l’origine le tableau s’appelait Don Pedro II dans le giron de sa gouvernante. Puis il a été rebaptisé Don Pedro et sa nounou, et plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, Domestique portant un enfant dans ses bras, effaçant au fil des années le rôle essentiel d’une gouvernante pour le réduire au statut de domestique. Comme si un empereur ne pouvait avoir pour préceptrice une femme noire dont les origines rappellent un passé colonial.
J’ai aussi été très frappée par des photos, datant de la fin du 19ème et du début du 20ème, partagées sur Internet et qui suscitent beaucoup de réflexions. On y voit des bébés américains, blancs et bien nés, poser devant l’appareil des photographes de l’époque. Celles qui tiennent ces bébés sont mystérieusement cachées derrière un voile noir, on ne voit qu’une main gantée dépasser. À qui appartient cette main, qui est derrière le voile ? Ce sont en fait les nourrices de ces enfants, des femmes noires, qu’on dissimulait derrière un drap pour qu’elles n’apparaissent pas à l’image. Elles étaient les seules à pouvoir maintenir l’enfant sage et tranquille pendant les séances de pause. Les mères, que les bébés connaissaient mal, n’y parvenaient pas. Mais on a effacé les nourrices de l’image car ce n’était pas convenable. Une nourrice noire ne pouvait pas tenir une place maternelle et éducative. Mon film s’inscrit dans ce désir de soulever le voile.
Votre rencontre avec la Capverdienne Ilça Moreno, qui interprète Gloria, a été déterminante ?
J’ai rencontré beaucoup de nounous, de plusieurs générations. Elles m’ont confié leurs histoires. Et puis j’ai rencontré Ilça Moreno par l’intermédiaire de la directrice de casting qui a eu un coup de foudre pour elle, suite à une première rencontre et un premier essai. Ilça ressemble énormément au personnage de Gloria. Son parcours est très proche de celui du film, à moins que ce ne soit l’inverse. A l’origine, elle est infirmière au Cap-Vert. En arrivant en France, elle s’est occupée d’enfants, en particulier d’un garçon handicapé, avec qui elle a vécu deux ans et dont elle était très proche. Elle m’a raconté pudiquement une partie de sa vie, son village et ses trois enfants qu’elle a dû laisser à sa mère. La rencontre avec Ilça m’a permis d’enrichir le scénario, de l’inscrire dans la réalité d’un pays. Ilça avait fait un peu de théâtre au Cap-Vert, elle est drôle, avait des dispositions naturelles. Puis, elle a le goût des aventures et l’idée de retourner au Cap-Vert pour un film l’animait beaucoup. Alors on a décidé d’embarquer ensemble dans cette aventure.
Lors de nos premiers repérages au Cap-Vert avec Bénédicte Couvreur, ma productrice, on s’est aperçues que l’histoire de Gloria et ses enfants était celle d’à peu près toutes les personnes que l’on rencontrait. Comme Fredy Gomes Tavares, qui joue César dans le film, dont la mère est en France et qu’il n’a jamais vue. Et Abnara Gomes Varela qui joue Fernanda... Beaucoup d’enfants sont ainsi élevés par une grand-mère, une tante, un oncle.
Le récit du film est construit du point de vue d’une petite fille de six ans à peine…
Oui, c’était fondamental pour moi. La question du regard, je me la suis énormément posée, en amont, en aval, pendant le tournage et le montage. C’est le point de vue d’une enfant et non celui du documentaire. Ce qui primait pour moi était de travailler le hors-champ. L’idée était de resserrer la vision de l’enfant sur ce qu’elle ressent et de recentrer tout le film à travers ce prisme. Et donc dans le film ce qu’on voit du Cap-Vert, c’est surtout ce qu’on en imagine, ce fameux hors-champ. Ça me permet de ne pas avoir un discours de carte postale, ni prétendument réaliste, et d’être avant tout sur le terrain des sensations et du sentiment.
Le regard de cette petite fille est particulier car elle porte des lunettes, c’est même la première chose qu’on découvre d’elle. Pourquoi ?
Je suis myope comme une taupe, ce qui, j’imagine, crée une manière particulière de retranscrire le monde, notamment au cinéma. Et puis quand on est myope, on appréhende les choses moins par le visuel que par le mouvement, l’auditif, le kinesthésique… J’ai tenu à ce que cette petite enfant à lunettes perçoive le monde de cette façon, multiple et sensorielle. C’est ainsi que j’ai imaginé la mise en scène. Elle écoute beaucoup, il y a beaucoup de plans sur son oreille, elle touche les objets et les matières. Louise, qui joue Cléo, n’est pas du tout myope, elle a joué la myopie.
Elle était hyper fière d’avoir des lunettes, elle en prenait soin comme la prunelle de ses yeux. Dès qu’elle les mettait, elle rentrait dans son personnage. Elle devenait Cléo.
Comment avez-vous choisi Louise ?
Nous ne voulions pas d’enfant déjà inscrit dans des réseaux de casting. Je voulais quelqu’un qui tourne pour la première fois. Nous avons donc orienté nos recherches en ce sens. La directrice de casting a remarqué Louise dans un parc, elle était très directive avec son petit frère, ça lui a plu. Elle montrait déjà un fort caractère. Elle est venue passer des essais et j’ai tout de suite senti une chose que je crois assez rare chez les enfants de son âge : une écoute et une faculté incroyable à se mettre à la place des autres. Empathique en un sens. Et puis elle avait quelque chose d’extrêmement normal, elle n’était ni l’enfant trop « choupinou » ni l’enfant « sauvage ». Dans un second temps, la rencontre entre Ilça et Louise et leurs essais filmés nous ont convaincues de partir avec elles deux.
Le film est le parcours de deux émancipations : celle d’une femme qui revient dans son pays pour ne plus être l’employée de qui que ce soit et devenir indépendante, et celle d’une enfant qui apprend à grandir et s’aventurer dans la vie. Ce sont deux parcours vers l’indépendance, mais une indépendance qui a un prix, celui de l’amour qui les unit.
La partie capverdienne a été tournée à Tarrafal au nord de Santiago, la plus grande île de l’archipel.
C’est un territoire très volcanique. Et pour moi, l’enfance c’est ça. C’est pas du tout un territoire tranquille. C’est un terrain volcanique, débordant de tout : dans tes relations, dans ton imaginaire, dans ton ressenti du monde, où tout est une épopée. C’était d’ailleurs l’enjeu de la mise en scène. Je voulais un film sensoriel, où tout reste à vie, en vous, pour toujours, comme marqué au fer rouge.
Cette partie du film est en créole et non en portugais.
Même si le portugais est la langue officielle du pays, je tenais à ce que le film soit dans la langue parlée sur l’île. Le créole, c’est la langue des esclaves, une langue qui n’est pas apprise à l’école, une langue elle aussi taboue en un sens, depuis l’époque coloniale. J’ai pris des cours de créole grâce à Arlindo Semedo Varela, qui est ouvrier en France et qui a la volonté de transmettre sa langue. Il a été un prof extraordinaire, très patient. Il a utilisé des chansons capverdiennes pour m’apprendre les rudiments du vocabulaire et la richesse de la poésie créole.
C’est une chose à laquelle je suis très attachée. J’ai un père géorgien, on l’obligeait à parler russe au temps de l’Union Soviétique, or sa langue à lui, c’était le géorgien. Il fallait donc faire survivre la langue en contre-pouvoir à l’impérialisme de l’époque. Par ailleurs, j’ai fait des études en Catalogne, j’ai saisi l’importance du catalan, et j’admire ceux qui se battent pour leur langue. Ça n’a rien à voir avec le nationalisme, contrairement à ce qu’on peut parfois penser en France.
Et j’aime surtout l’idée de ne pas toujours saisir ce qu’on me dit mais de ressentir ce qui est énoncé, comme une musique dont on comprend les nuances même si on n’a pas fait de solfège. C’est d’ailleurs le point de vue de Cléo : de temps en temps, quand les échanges se font en créole, elle n’a pas besoin de sous-titres pour comprendre que l’enjeu est sentimental et quelle en est la portée. Cela n’est pas toujours facile à mettre en scène, et pose la question de ce que l’on traduit ou pas, mais j’y tenais beaucoup.
Dans le film, il y a une première partie en région parisienne, une deuxième au Cap-Vert, et une troisième enchâssée aux deux autres qui serait le territoire de l’animation. Qu’est-ce que l’animation montrait que ne pouvait montrer la prise de vue réelle ?
L’animation est pour moi l’accès le plus direct au monde intérieur de l’enfant, à ce que Cléo ressent et n’arrive pas à dire parce qu’elle n’a pas les mots. Quand tu es gamin, tu entends des bribes d’histoires racontées par les adultes que tu ne comprends pas, parce qu’on ne prend pas la peine de te les expliquer, ou parce qu’on se dit qu’il faut t’épargner, ou parce que c’est dans une autre langue… Alors tu te crées des mondes incroyables. J’ai tenu à montrer avec l’animation comment Cléo s’imagine le départ de Gloria vers la France. J’ai entendu des récits d’exil dans ma famille, des récits multiples et rocambolesques, mais on ne me disait pas tout parce que les contextes politiques étaient compliqués, alors je fantasmais, j’inventais mes propres images.
Par ailleurs, j’avais déjà co-réalisé un court métrage d’animation, I want Pluto to be a planet again, avec Vladimir Mavounia-Kouka. J’aime le processus de création de l’animation. J’ai une passion pour les rythmes d’ateliers… C’est un autre rapport au temps qu’au cinéma. J’ai moi-même grandi dans l’atelier de mon père, orfèvre, près d’une forge, entourée d’une enclume et de centaines de marteaux. C’est un rythme qui me réconforte. Le foyer, c’est ça pour moi.
Pour àma Gloria, j’ai demandé à Pierre-Emmanuel Lyet, un ami, illustrateur et auteur jeunesse, de co-réaliser l’animation avec moi et de prendre en charge le travail de recherches graphiques et de design. Nous avions comme référence Peter Doig et Félix Vallotton, des coloristes incroyables. Doig pour le mystère qui émane de ses toiles, Vallotton pour son talent à saisir comme si de rien n’était une brève de vie, un moment volé, un bout de ciel qui vous reste gravé à tout jamais et vous perce le cœur. Fidèles à nos références, nous avons fait le choix de la peinture animée image par image au banc-titre : à la main et au pinceau, donc. Et pour les fonds et les décors, nous avons au contraire utilisé une technique très moderne sur le logiciel procreate. La gageure était de faire en sorte que ces deux techniques puissent coexister. D’une séquence à une autre, nous ne pouvions reproduire une méthodologie. Toute cette matière s’est donc inventée de manière très artisanale, avec une équipe essentiellement féminine. Avec ce principe d’animation, on n’a pas le droit à l’erreur, le découpage est au cordeau, on ne peut pas revenir en arrière. Ce n’est pas un cinéma du remords, il n’y a pas d’autre choix que d’avancer !
Entre Gloria et Cléo, c’est aussi une histoire de regards…
Je voulais que Cléo cherche Gloria du regard. Tout le sujet du film, c’est comment on se regarde, d’où on se regarde. Même s’il y a la distance, les années, la vie, on continue de se regarder. Parce qu’on s’est aimé. Dans le fond, Cléo sait qu’elle pourra toujours se retourner vers cette femme, ou du moins vers son souvenir. C’est comme dans la chanson du film, Mes yeux dans ton regard, de Nilda Fernandez. C’était mon voisin quand j’étais petite, il habitait dans le 18ème, je le croisais tout le temps. Un homme tout petit avec des cheveux très longs et une voix très androgyne. Laurinda l’écoutait dans sa loge, il était une star à l’époque. J’adore qu’il dise son numéro de téléphone dans la chanson, c’est complètement hors temps, et tellement mélo.
(Dossier de presse)