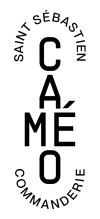Anatomie d'une chute
Entretien avec Justine Triet, réalisatrice
Quel est le point de départ d’Anatomie d’une chute ?
Je souhaitais faire un film sur la défaite d’un couple. L’idée, c’était de raconter la chute d’un corps, de façon technique, d’en faire l’image de la chute du couple, d’une histoire d’amour.
Ce couple a un fils qui découvre l’histoire de ses parents dans un procès - procès qui dissèque méthodiquement leur relation - et ce garçon passe du stade de l’enfance, incarné par la confiance absolue envers sa mère, à celui du doute. Et le film va regarder ce passage. Dans mes précédents films, les enfants étaient présents, mais n’avaient pas la parole, ils étaient là ; mais on n’avait pas leur point de vue. C’est comme si le moment était venu d’intégrer le regard de l’enfant au récit, de le mettre en balance avec celui de Sandra, le personnage central.
Le film est peu à peu devenu comme un long interrogatoire : de la maison au tribunal, ce n’est qu’une succession de scènes où les personnages sont questionnés.
J’ai voulu revenir à plus de réalisme, dans le sens quasiment documentaire, que ce soit à l’écriture ou formellement. Mais c’était pour aller plus loin dans la complexité, dans ce que raconte le film autant que dans les émotions qu’il peut produire. Tout a été vers un plus grand dépouillement : il n’y a aucune musique additionnelle, le film est plus brut, plus nu que mes précédents.
Le premier plan du film est déroutant, c’est une balle qui tombe d’un escalier.
Il y a une obsession de la chute dans le film, d’abord de façon très physique, concrète. Comment ça fait quand quelque chose tombe ? Cette idée du « poids du corps », d’un corps qui tombe, je l’ai en tête depuis longtemps, notamment depuis le générique de « Mad men », cet homme qui n’en finit pas de tomber…
Dans mon film, on ne fait que monter et descendre des escaliers, regarder d’en bas vers le haut, du haut vers le sol, tenter de comprendre comment la chute s’est produite. Alors, il fallait rentrer dans le film par le côté : une balle tombe, rattrapée par le chien, qui vient regarder Sandra, notre personnage, et nous dire: c’est elle qu’on va essayer de comprendre, qu’on va regarder pendant 2h30.
La bataille du couple avec un enfant est au centre du film
C’est un film sur le couple et sur le partage du temps. L’enfant est au centre de ce partage. Et dans un couple, qu’est-ce qu’on se doit ? Qu’est-ce qu’on se donne ? Est-ce qu’une réciprocité est possible ? Ce sont des questions qui me travaillent et qui ne sont pas tant que ça abordées au cinéma.
Ici, Sandra Voyter est une écrivaine reconnue, et son mari est professeur, fait classe à leur fils à la maison, tout en essayant d’écrire lui-aussi. Il y a évidemment une déconstruction du schéma archétypal du couple. Les rôles sont inversés, je montre une femme, qui en assumant totalement sa liberté et sa volonté, crée un déséquilibre. L’égalité dans le couple est une utopie magnifique mais très difficile à obtenir, et Sandra décide de prendre sans demander, sachant très bien que sinon on ne lui donnera rien. Cette attitude est à la fois puissante et questionnable, et le film ne fait que ça : il questionne.
Le couple, c’est des tentatives de démocratie qui sont sans cesse interrompues par des pulsions dictatoriales. Et ici, c’est presque devenu une guerre, avec une dimension de rivalité. Ils se sont piégés, et quelque chose a été perdu, parce que personne n’a rien voulu lâcher. Mais ce sont de grands idéalistes, j’aime ces gens pour ça, ils ne sont pas résignés. Même dans la scène de dispute, qui est en fait une négociation, ils continuent à se dire la vérité, donc pour moi il reste de l’amour.
Vous avez co-écrit avec Arthur Harari. Le scénario n’est pas adapté d’un fait réel et pourtant il fourmille de détails, en particulier juridiques, qui paraissent plus vrais que nature. Vous avez fait appel à des experts ?
Oui, Arthur a véritablement écrit le film avec moi, ça a été un partage complet du travail. Et puis, on a été conseillés par un avocat pénaliste, Vincent CourcelleLabrousse, qu’on appelait tout le temps pour nous aider sur les aspects techniques, mais aussi sur la conception française de l’audience. Ce qui nous a surpris, c’est le côté un peu bordélique d’un procès en France, contrairement aux Etats-Unis où la parole est distribuée de façon plus rigide. Cet aspect m’a permis de faire un film très français, et de prendre le contre-pied du film de procès américain, beaucoup plus spectaculaire. L’idée d’assister à des blocs ininterrompus d’audience s’est imposée. J’ai passé mon temps à demander à mon monteur, Laurent Sénéchal, de ralentir le rythme, de garder les plans imparfaits, flous, un peu tremblants. Je ne voulais pas d’un film confortable, trop propre. En tout cas, j’ai pris un nouveau plaisir formel avec ce film.
Vous avez écrit pour Sandra Hüller, n’est-ce pas ?
J’avais envie de retravailler avec elle, après SYBIL. J’ai écrit pour elle, elle le savait, c’est une des choses qui m’ont stimulée dès le départ. Cette femme libre qui est finalement jugée aussi pour la façon qu’elle a de vivre sa sexualité, son travail, sa maternité : je pensais qu’elle apporterait une complexité, une impureté au personnage, qu’elle éloignerait totalement la notion de « message ». Et puis, on s’est véritablement rencontré sur le tournage. Elle a amené une croyance, une vérité, qui transcende le scénario. C’est quelqu’un qui ancre le moindre dialogue artificiel dans une réalité qui passe par elle. Ou bien elle le rejette et me le renvoie à la figure. C’est très vivant, en tout cas ; elle arrive et elle a un point de vue fort, tout passe par son corps. Elle imprime chimiquement le film comme peu d’acteurs. A la fin du tournage, j’ai eu l’impression qu’elle m’avait donné une part d’elle, réellement. Et que ce que j’avais capturé ne pourrait pas se reproduire.
Tout le jeu autour des langues — le français, l’anglais, l’origine allemande — ajoute une couche de complexité au procès, ainsi qu’une forme d’opacité au personnage de Sandra…
Oui, ça continue de nourrir la distance qu’on a avec elle, une étrangère jugée en France, qui doit se plier à la langue de son mari et de son fils. C’est une femme qui s’est construite en plusieurs strates, que le procès va explorer. Enfin, ça m’intéressait de regarder la vie d’un couple qui ne parle pas la même langue, ça rendait concret la négociation entre eux jusque dans le langage, avec l’idée de la langue tierce comme terrain neutre.
Samuel Theis, vous l’aviez aussi en tête dès le début ? Non, j’ai vu beaucoup d’acteurs pour ce rôle, mais ironiquement, le personnage s’appelait déjà Samuel. Il apparait peu dans le film, mais il est essentiel au récit, il le hante littéralement, il fallait qu’il nous capte immédiatement. Je dois bien avouer que je le trouve très beau, j’adore sa voix, son apparente douceur qui cache quelque chose de beaucoup plus dense, j’avais envie de le filmer. Il a quelque chose « d’épais », c’est une chose que j’adore, l’épaisseur chez les acteurs. Là aussi, c’est à la fois physique et intérieur, il y a des couches.
Et Milo Machado Graner, qui joue l’enfant, vous avez eu du mal à le trouver ?
Oui, ça a pris du temps. Avec Cynthia Arra (ma collaboratrice au jeu d’acteur), on a d’abord fait quatre mois de casting d’enfants malvoyants, puis comme on ne trouvait pas, on a ouvert aux enfants voyants encore trois mois supplémentaires avant de tomber sur Milo. C’est Jill Gagé (en renfort casting) qui l’a trouvé. Il a tout suite été impressionnant, comme s’il ne jouait pas. Il a appris le piano de manière intensive, et puis, avec Cynthia, on a cherché ensemble le niveau de malvoyance avec l’aide de personnes spécialisées dans la déficience visuelle. Nous avons opté pour une malvoyance qui soit la plus légère possible à incarner, une forte myopie sans atteinte de la vision périphérique. C’est un enfant qui a des capacités intellectuelles et émotionnelles exceptionnelles, avec une espèce de vibration mélancolique.
On sent, dans les scènes de tribunal, une jouissance du verbe, de la joute verbale. Antoine Reinartz y est pour beaucoup. Comment l’avez-vous choisi ?
Je l’ai choisi pour la modernité qu’il donnait au personnage. Il amène de l’altérité dans le film, il fait rentrer le monde contemporain et ça casse la solennité poussiéreuse du procès… Il joue en quelque sorte le méchant, mais un méchant très séduisant, retors, flamboyant. Il parle à la place du mort et doit rendre ce dernier, qu’on ne voit pratiquement jamais, attachant, nous faire saisir, comme aux jurés, que cet homme mérite d’être défendu. Antoine apporte une dimension d’arène au tribunal, la violence civilisée du parquet.
Au contraire, Swann Arlaud joue un personnage assez fragile, sensible, sur la défensive…
Oui je ne voulais pas de combat de coq entre eux. Son personnage, Vincent, n’est pas un virtuose du barreau, il est bon mais pas idéalisé. Swann amène une subtilité de jeu, une appréhension, du fait qu’il connait sa cliente, il se sent du coup plus en danger. Je trouvais intéressant qu’il soit en quelque sorte un double de Samuel, que les deux se ressemblent un peu. On comprend que Sandra et lui se sont connus il y a des années, et qu’il y a entre eux quelque chose de pas totalement éteint.
Et puis, Vincent Courcelle-Labrousse (notre consultant avocat) nous avait dit : on est tout le temps sollicité par des amis qui veulent qu’on les défende, et c’est toujours un piège. Cette notion de piège, ou en tout cas de distance difficile voire impossible à trouver, c’était important pour l’identité de ce duo. On sent que quelque chose d’autre se joue, et probablement que Sandra en a besoin pour se sentir soutenue. Swann est génial pour faire exister toutes ces dimensions sans dialogues : c’est là, ça transpire.
Le film n’a aucun flash-back, à une exception près, très puissante : la scène de dispute.
L’absence de flash-back était une volonté dès le départ. Je n’aime pas ça dans les films, et surtout je voulais que la parole soit au centre, qu’elle assume tout, qu’elle envahisse tout. C’est comme ça que fonctionne un procès : la vérité échappe, il y a un énorme vide et on n’a que la parole pour le combler. Les seules exceptions qu’on s’est autorisées, elles passent par un travail de son. Et en réalité ces exceptions ne sont pas des flash-back : dans la scène de la dispute il s’agit d’un enregistrement sonore qui s’incarne soudain à l’image, il y a donc une qualité de présent, car le son enregistré produit cela. Ça crée un manque et c’est presque plus puissant que l’image je trouve : c’est à la fois de la pure présence et c’est fantomatique.
Il y a aussi la scène où Daniel reconstitue la parole de son père mort, mais elle appartient à un autre régime : on a cette fois l’image, mais c’est le récit d’un souvenir, voire une invention, en tout cas un témoignage sans preuve, comme le souligne l’avocat général.
Au fond, le tribunal est le lieu où notre histoire ne nous appartient plus, où elle est jugée par d’autres, qui doivent la reconstituer à partir d’éléments épars, ambigus. Ça devient forcément de la fiction, et c’est précisément ce qui m’intéresse.
(Dossier de presse)